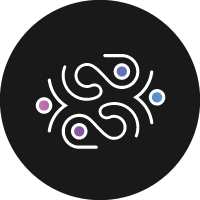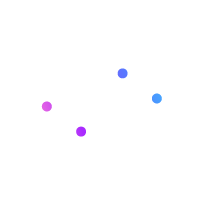Chaque mois, nous partons à la rencontre d’acteurs de l’écosystème de la santé valaisan et mettons en lumière les projets innovants qui font la médecine de demain. Aujourd’hui, nous sommes allés à la rencontre de la Dre Raphaëlle Luisier, chercheuse et responsable du premier laboratoire de bio-informatique de l’Idiap, à Martigny. Lumière sur ce nouveau groupe de recherche qui jette un pont entre l’informatique et la santé.
Renommé mondialement pour ses avancées dans les domaines de l’informatique, de l’intelligence artificielle et les interactions homme-machine, l’institut de recherche Idiap vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc en 2019, en créant le premier groupe de recherche en bio-informatique. A sa tête, Dre Raphaëlle Luisier vise à faire fructifier l’expertise de l’institut en informatique au profit de la recherche génétique. Les recherches du laboratoire de bio-informatique poursuivent deux objectifs : analyser la manière dont les neurones moteurs lisent les quelque 20’000 gènes humains et le comportement de ces cellules dans le temps en fonction d’un grand nombre de variables dont elle va nous parler dans l’interview ci-dessous.
En quelques mots, quel est votre parcours professionnel ?
J’ai débuté une formation d’ingénieur à l’EPFL, dans les sciences de la vie. Durant mon master, je suis partie en travail de recherche en Australie pour faire de la modélisation mathématique de tissus en évolution. Après mon master, je suis revenue en Suisse pour effectuer quelque temps de la recherche à l’EPFL, puis effectuer mon doctorat à l’Université de Bâle et travailler au sein de Novartis, en bio-informatique. A ce moment-là, j’avais décidé de quitter le laboratoire complètement et de privilégier l’analyse de données. Cette expérience m’a permis de voir ce qui se faisait en industrie, tout en étant certaine de vouloir continuer dans un environnement académique.
Puis, pour mon postdoctorat, je suis partie à Londres pour me concentrer sur les maladies neurodégénératives. C’est devenu mon sujet. J’ai débuté ma collaboration avec le Prof. Rickie Patani qui dirige le laboratoire des cellules souches humaines et de la neurodégénérescence de l’Institut Francis Crick de Londres. Cela fait maintenant 6 ans que nous travaillons ensemble. À la fois chercheur et clinicien, il a accès à des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) et aux banques de données de tissus de l’Université de Londres (UCL). C’est une source incroyable ! Nous travaillons vraiment main dans la main : on identifie les questions ensemble, il réalise les expériences, j’analyse les données, etc. Et après Londres, je suis revenue m’établir en Suisse et j’ai commencé à travailler au sein de l’Idiap pour monter ce nouveau laboratoire de bio-informatique.
Pourquoi avoir choisi l’Idiap ?
Ma vision dans le futur, c’est de faire de l’intégration de données multimodales. J’ai basé tout mon début de carrière sur l’analyse de données moléculaires, mais j’étais certaine que je voulais les intégrer à des données cellulaires. Pour cela, je devais trouver un endroit où travailler qui était bon en imagerie. De plus, dans mon domaine (ndlr. la bio-informatique), on part d’une question biologique et on reste toujours à l’écoute des meilleurs outils d’analyse pour y répondre. L’Idiap offre un panel impressionnant d’outils pour y répondre (du speech, du natural language processing, de la biométrie, etc). Tous les outils utilisés sont applicables en bio-informatique !
Vous dirigez depuis un peu plus d’1 an le laboratoire de bio-informatique. Quelle est sa raison d’être ?
L’identité du laboratoire de bio-informatique est de faire le pont entre la santé et l’informatique. Il regroupe des gens qui ont des connaissances de biologie et de mathématique. Dans l’année qui s’est écoulée, nous avons continué de faire des avancées en biologie moléculaire (deux papiers ont été publiés). Nous avons aussi ancré notre expertise en imagerie avec cette publication.
Nous nous concentrons certes sur la SLA (sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot), mais nos recherches peuvent s’étendre à n’importe quelles maladies neurodégénératives, car leurs spectres se recoupent tous un petit peu. Les outils que nous utilisons sont applicables partout.
Qu’est-ce que la SLA (sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot) ? Où en est la recherche sur cette maladie ?
Quand j’ai débuté mes recherches à Londres, il y a maintenant 6 ans, il avait très peu de connaissances sur la SLA. Des biomarqueurs venaient d’être découverts. Il faut savoir qu’à l’inverse de la maladie d’Huntington, qui est 100% génétique, nous ne connaissons que 10% de cas dits « familiaux » pour la SLA. Évidemment qu’il y a une base génétique partout, mais l’interaction avec l’environnement semble assez importante aussi. C’est donc une maladie très « compliquée », ce qui la rend d’autant plus intéressante pour un chercheur.
En quoi consiste votre dernière publication sur cette maladie ?
Dans cette publication nous avons proposé une nouvelle manière de faire de l’histopathologie, c’est-à-dire d’analyser les tissus de patients atteints par la SLA. Grâce cette nouvelle méthode qui utilise ce que l’on appelle le ‘machine learning’, nous avons découvert que les cellules nerveuses chez les patients atteints par la SLA avaient des caractéristiques très particulières en ce qui concerne leur forme.
Pour remettre le contexte, à la base, le biologiste procède toujours de la même manière pour analyser un tissu : il prend un tissu chez une personne malade, le couper et en faire des colorations qui vont révéler certains aspects spécifiques (par ex. la structure du tissu, la forme des cellules, etc.). Il mesure la coloration dans chaque cellule. Puis, il effectue une moyenne de ces mesures et il compare le groupe malade vis-à-vis du groupe contrôle.
Dans le cadre de cette étude, j’ai utilisé deux outils : le data mining et le machine learning, en partant du principe que je ne savais pas quelles mesures pouvaient peut-être prédire la maladie SLA et que pas toutes les cellules n’étaient malades dans le tissu prélevé. Il s’agit toujours d’analyse de cellule unique (single-cell analysis).
L’hypothèse de départ est que nous savons que nous avons des cellules malades, mais nous ne savons pas où elles se trouvent. Elles peuvent être aussi chez la personne saine ! Car en réalité une personne saine peut aussi avoir les mêmes comportements cellulaires, mais de manière moins fréquente. Les données de toutes les cellules vont être analysées, malades, non malades, appartenant au patient A, B, C, ou D, sans procéder à aucune exclusion. Des milliers de paramètres vont être mesurés. On agglomère toutes ces mesures et on va laisser les données parler, c’est-à-dire il y a un modèle (ndlr pattern en anglais) qui va émerger.
Nous avons également donné un score à chaque cellule de chaque patient. Suivant une échelle, nous allons pouvoir donner une probabilité d’être malade à la fois au niveau de la cellule et puis, pour le patient, nous allons pouvoir lui communiquer la fréquence des cellules malades dans ce tissu.
Quels sont les prochaines étapes ?
Dans le futur, nous pouvons imaginer couper différentes parties de la moelle épinière pour savoir si la maladie se propage de manière régulière, si elle se déclare plutôt en haut ou en bas, si les cellules malades sont présentes en amas ou de manière aléatoire, etc. Tout cela est encore inconnu aujourd’hui !
La nouvelle méthode que nous avons proposée va amener le pathologiste à utiliser du machine learning de manière directement applicable. Il s’agit maintenant de sensibiliser les histopathologistes avec ce qui peut être fait avec leurs données. Avec cette étude, nous avons voulu partager une méthode d’analyse et encourager à monter des équipes pluridisciplinaires pour répondre à ce genre de question. Mon objectif au sein de l’Idiap est de jeter des ponts entre les recherches fondamentales d’intelligence artificielle vers l’applicabilité, que les outils soient directement utilisables en médecine.
>> WHAT’NEXT ? Aujourd’hui, Raphaëlle Luisier et Rickie Patani travaillent sur une publication à venir qui présentera une nouvelle méthode d’analyse, cette fois-ci en utilisant le deep learning. Au lieu d’effectuer des mesures prédéfinies dans la cellule, cet outil permet l’abstraction et ainsi une meilleure identification des modifications liées à la maladie au sein des arborescences des cellules neuronales… A suivre !
>> EN + : Découvrez la dernière publication de Raphaëlle Luisier : Automated and unbiased discrimination of ALS from control tissue at single cell resolution – Hagemann – – Brain Pathology – Wiley Online Library