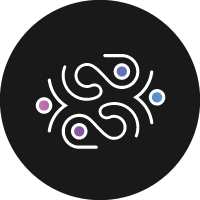Le traitement des douleurs chroniques peut parfois s’avérer complexe car plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Il est important de catégoriser la pathologie afin de pouvoir prescrire le traitement adéquat. La douleur étant un sentiment hautement subjectif peu d’outils existent pour la mesurer. Le clinicien dispose d’une batterie de questionnaires lui permettant de définir son type, son degré d’intensité et même sa localisation. Cependant, il n’existe que peu d’outils objectifs pour mieux caractériser les douleurs chroniques.
Pour pallier cette difficulté, des scientifiques de l’Université de Genève (UNIGE) se sont associés au service de recherche de la Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion afin de procéder à une analyse épigénomique complète de patients souffrant de douleurs chroniques. L’analyse épigénomique s’intéresse à l’ensemble des modifications épigénétiques d’une cellule. Ces modifications sont réversibles (au contraire des mutations qui, elles, sont définitives), adaptatives (les cellules vont s’adapter à l’environnement) et transmissibles (via les gamètes qui seront transmises à la génération suivante). La CRR et l’UNIGE ont donc entamé un travail visant à cartographier les biomarqueurs de différents types de douleur afin de pouvoir les catégoriser et les traiter en conséquence dans le futur.
Catégoriser la douleur
« À la CRR, nous traitons de nombreuses personnes souffrant de douleurs chroniques. Nous nous sommes alors demandé si, en nous associant avec le laboratoire de la Prof Ariane Paoloni-Giacobino de l’UNIGE, nous pourrions définir des biomarqueurs spécifiques à chaque type de douleur, afin de les catégoriser de manière rapide et fiable. », explique le Dr Bertrand Léger, chef du service de recherche de la CRR et dernier auteur de l’étude.
La douleur induit une réponse spécifique au niveau de l’ADN. L’analyse épigénomique permet ainsi de trouver les indicateurs propres à chaque catégorie de douleur. En effet, ces dernières n’ont pas toutes les mêmes origines. Les cliniciens les distinguent en plusieurs catégories dont deux principales : les douleurs nociceptives – les plus répandues – qui résultent d’une activation des récepteurs situés au bout des fibres nerveuses, et les douleurs neuropathiques qui découlent soit d’une lésion de la structure nerveuse due à une compression ou à la section d’un nerf soit d’un trouble du fonctionnement de cette structure. Afin de soulager efficacement le patient et pouvoir lui apporter le traitement adéquat, il faudrait pouvoir facilement et précisément identifier cette origine. Pour ce faire, une simple prise de sang suffit puisque ces paramètres sont facilement mesurables dans la circulation. Par la suite, les chercheurs vont observer si les biomarqueurs modifiés par la douleur reviennent à la « normale » en réponse aux traitements prescrits.
Des résultats étonnants
Dans le cadre de la recherche, l’équipe de l’Université de Genève a effectué une analyse des génomes sur un panel de 57 patients. « L’objectif était de partir sans hypothèse préalable, afin de sonder le génome dans son ensemble et d’identifier tous les biomarqueurs impliqués dans la douleur », précise Ariane Giacobino, co-dernière auteure de l’étude et professeure au Département de médecine génétique et développement de la Faculté de médecine de l’UNIGE.
Les scientifiques ont pu identifier des signatures épigénétiques (caractérisée par le fait que l’expression d’un gène se trouve modifiée durablement) très frappantes signalant la douleur. De plus, ils constatent qu’il y a une absence totale de similitudes entre les deux catégories de douleur : nociceptive et neuropathique. La signature épigénétique est donc directement liée à l’origine de la douleur.
« Cette absence totale de similitudes entre les deux catégories de douleur est très étonnante, car intuitivement, nous pourrions penser que la difficulté à définir sa douleur provient d’une similarité dans la signature épigénétique, ce qui n’est en réalité absolument pas le cas », relève Ariane Giacobino.
Un traitement approprié pour un retour à la normale
« Maintenant que ces signatures épigénétiques sont clairement définies, une simple prise de sang permettra d’effectuer une recherche sur ces biomarqueurs, afin de définir de quel type de douleur souffre la personne, et prescrire le traitement approprié », se réjouit Bertrand léger. Le traitement se fera ainsi sur la base de l’origine de la douleur et non pas sur la base des symptômes. L’objectif réside dans la volonté de revenir à la normale grâce à l’administration d’un bon traitement.
Au niveau scientifique, le but principal est d’objectiver la douleur et d’offrir des nouvelles cibles thérapeutiques. Il sera ainsi plus simple de comprendre l’origine de la douleur et de la soigner à la racine en fournissant le traitement adéquat.
Cette recherche initiée par la Clinique romande de réadaptation a connu une visibilité d’envergure tant sur le pan national qu’international. Plusieurs articles sont parus notamment dans la célèbre revue médicale américaine du Journal of Pain. Une nouvelle avancée scientifique qui a permis à la CRR de faire rayonner son expertise au-delà de nos frontières.