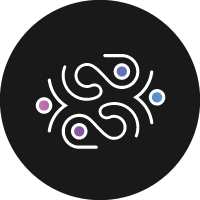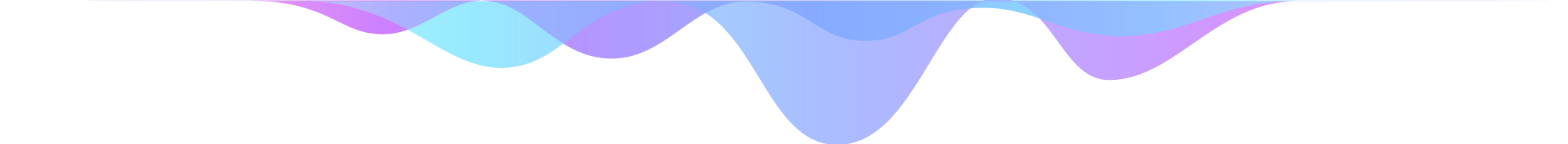Chaque mois, nous partons à la rencontre d’acteurs de l’écosystème de la santé valaisan et mettons en lumière les projets innovants qui font la médecine de demain. Les innovations qui aident les personnes à surmonter les problèmes de mobilité, de vue et autres handicaps ont connu une forte croissance durant ces dernières années et ces « technologies d’assistance » sont de plus en plus intégrées aux biens de consommation.
Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les tendances technologiques 2021 : Assistive Technologies (WIPO Report Finds Significant Growth in Assistive Technologies as they Find Greater Application in Consumer Goods), plus d’un milliard de personnes ont actuellement besoin de technologies d’assistance. Dans le même temps, l’électronique grand public et les produits d’assistance convergent, ce qui signifie une commercialisation encore plus importante de ces technologies. Le rapport montre que les innovations, qu’il s’agisse de petites améliorations apportées aux produits existants ou de développements de pointe dans les technologies d’avant-garde, peuvent améliorer considérablement la vie des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Ces technologies les aident à surmonter les obstacles quotidiens pour naviguer dans leur environnement, communiquer, travailler et vivre de manière indépendante. Afin d’obtenir un éclairage valaisan sur cette thématique, nous avons rencontré Benjamin Nanchen, responsable du Living Lab Handicap, réseau de co-création fondé par la HES-SO Valais-Wallis en collaboration avec la Fondation pour la Recherche en faveur des personnes Handicapées (FRH), et Julien Torrent, responsable de l’innovation de l’Institut de recherche Icare.
Pourriez-vous nous présenter le Living Lab Handicap ?
Depuis 2018, la HES-SO Valais-Wallis et la FRH se sont doté d’un outil de collaboration et de co-création, dénommé : Living Lab Handicap (LLH). Un espace d’échange mettant en relation des personnes en situation de handicap, des scientifiques, des entreprises et toutes autres personnes intéressées à collaborer à la co-création de nouvelles solutions innovantes.
Le Living Lab Handicap a pour vocation la création d’une plateforme d’innovation destinée au handicap au sens large, le but étant de réaliser de nouvelles solutions technologiques et/ou services qui peuvent leur venir en aide. La mission du Living Lab Handicap est également de développer l’innovation avec et pour les personnes en situation de handicap. Ces dernières sont pleinement intégrées dans les processus d’innovation et dans les équipes de recherche.
Le Living Lab Handicap est accrédité par le réseau européen des Living Labs (ENoLL).
Pourriez-vous nous présenter l’Institut de recherche Icare ?
Depuis 1991, l’institut de recherche Icare articule ses travaux autour des besoins futurs des entreprises en développant compétences et savoir-faire. Les technologies informatiques de demain sont développées et mises en œuvre au travers de projets de recherche complexes. Pour les réaliser, Icare s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires composées d’acteurs incontournables du monde scientifique issus de nos grandes écoles ainsi que de l’industrie. Cette approche permet de transformer rapidement les résultats de la recherche en solutions pragmatiques pour les entreprises. En construisant modules après modules avec les partenaires hospitaliers (CHUV, SUVA, etc…), les médecins, les start-ups, les grandes industries et les plateformes d’innovation comme Swiss Digital Health, les équipes d’Icare savent tirer le meilleur de chacun pour l’intégrer dans de nouvelles solutions. Le lancement d’initiatives comme celles d’Innosuisse et ses « Innovation Booster » va renforcer ce type d’approches.
Qu’entend-on par « technologies d’assistance » et quels sont les domaines les plus impactés par ces dernières ?
Les technologies d’assistance sont tous les moyens qui permettent de palier une déficience, de fournir plus d’autonomie à une personne en situation de handicap. Il existe 3 types de technologies d’assistance : 1. les low-tech plutôt basées sur des approches mécaniques (béquilles, fauteuil roulant manuel, etc.) – 2. les mid-tech basées sur des technologies qui sont actuellement bien connues (fauteuil roulant électriques, synthèses vocales, suivi oculaire, etc.) – et 3. les hi-tech, basées sur des technologies relativement nouvelles (Holo-Lens, intelligence artificielle, interface cerveau ordinateur, etc.). Il y a toujours une certaine inertie entre l’émergence d’une nouvelle technologie et son adoption ou détournement pour le domaine du handicap. Quand on parle de technologies d’assistance électroniques et/ou informatiques, on parle généralement de « Téléthèses » (terme inventé par Jean-Claude Gabus, créateur de la FST – Fondation Suisse pour les Téléthèses).
Les 3 principaux domaines impactés par ces technologies sont : 1. La communication améliorée et alternative, qui consiste à redonner la parole à une personne qui l’a perdue, par âge ou par accident ou qui n’a jamais eu accès à la parole. Dans ce domaine, les synthèses vocales sont beaucoup utilisées. 2. L’accès ergonomique à l’ordinateur, qui consiste à fournir les adaptations nécessaires pour permettre à une personne d’utiliser un ordinateur quel que soit sa déficience, à l’aide de dispositifs adaptés (ex. claviers adaptés, souris de bouche, souris de tête, souris avec les yeux, etc.). 3. Le contrôle de l’environnement, domotique ou immotique, qui consiste à piloter son habitat de manière distante et à automatiser son lieu de vie.
De manière générale, tous les domaines de la vie courante sont impactés. Cela comprend notamment le domaine de la communication, des déplacements, de l’éducation, de l’habitation, des loisirs, des responsabilités, des soins personnels et de santé et de divers autres thématiques. Tous ces éléments s’intègrent dans la classification PPH qui signifie Processus de Production du Handicap.
En quelques mots, pourriez-vous nous expliciter les évolutions marquantes de l’innovation des technologies d’assistance ?
Benjamin Nanchen : le phénomène de digitalisation a engendré un passage du support physique au support digital. Pour illustration, nous pouvons citer les personnes avec une déficience visuelle qui ont de moins en moins recours au braille, car des supports digitaux comme les liseuses ont été conçues. Ainsi, leur smartphone peut aisément leur lire différents contenus. La digitalisation a changé de nombreux paradigmes, tout en introduisant simultanément des barrières. En effet, si par exemple un site web est mal programmé, la liseuse peut être induite en erreur ce qui engendre des difficultés pour les personnes en situation de handicap. Des normes d’accessibilité physique et numérique ont, par conséquent, été mises en place afin de simplifier l’usage des différentes commodités.
Julien Torrent : beaucoup de technologies existent, mais il manque souvent les ponts permettant de les faire communiquer. Par exemple, les fauteuils roulants électriques existent depuis bon nombre d’années, il est aussi possible de piloter un ordinateur avec les yeux depuis bien longtemps. Par contre, piloter un fauteuil roulant électrique avec les yeux est relativement innovant. Nous avons développé un prototype permettant de le réaliser, en 2009 déjà. Dans un autre domaine, nous avons réalisé une application permettant de faciliter la prise de commandes à table pour des travailleurs avec un handicap mental, pour le Martigny Boutique Hôtel. Avec un peu de créativité, les technologies actuellement permettent de facilement dessiner de nouveaux ponts.
Quel est votre opinion au sujet de cette croissance marquée dans les technologies d’assistance ?
Julien Torrent estime que les technologies permettent actuellement de plus en plus de libertés. De plus, l’ergonomie des produits n’est plus laissée de côté. Il n’est pas rare de pouvoir réutiliser une simple technologie disponible en grande surface pour satisfaire les besoins de certaines personnes en situation de handicap. Dans d’autres cas, des adaptations sont nécessaires, mais c’est beaucoup plus simple aujourd’hui qu’il y a 15 ans. Le marché s’est bien développé et les coûts sont beaucoup plus faibles.
Benjamin Nanchen, quant à lui, développe son point de vue en affirmant que dans le quotidien, il est difficile de lever des fonds pour développer une technologie d’assistance, car nous sommes rapidement confrontés à des obstacles comme le fait que la technologie ne concerne qu’un nombre restreint de personnes et donc que le marché n’est pas suffisamment large. Donc, cette croissance marquée des technologies qui ont un impact significatif sur les biens de consommation peut être bénéfique, car le marché s’élargit et n’est, par conséquent, pas uniquement limité au handicap. L’élargissement du marché permet de faciliter le développement des technologies d’assistance, car sinon cela ne se fait pas ou peu. Plus la cible est large, plus des fonds peuvent être débloqués pour concrétiser un projet. Le point primordial repose sur le fait qu’il faudrait éviter de créer des technologies qui vont exclure un pan de la population. Il faut faire attention, car il arrive que nous développions une technologie qui engendre implicitement des barrières.
Quelles connexions pourrions-nous faire entre les technologies d’assistance, les biens de consommation électroniques et les technologies médicales générales ?
Le domaine des technologies d’assistance converge avec les biens de consommation électroniques et les technologies médicales générales. Les technologies d’assistance visent à compenser un handicap. Les biens de consommation génériques, quant à eux, ambitionnent de faciliter l’accessibilité en évitant l’exclusion d’un public. Ils intègrent des normes dessinant une ligne directrice pour que différents éléments deviennent accessibles. En ce qui concerne les technologies médicales, nous retrouvons deux modèles pour le handicap: médical et social. Le modèle médical du handicap vise à guérir, soigner, réparer les individus. Le problème, dans ce cas, est individuel, propre à chaque personne. Ce modèle concerne notamment l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui cible la classification internationale du fonctionnement. Le second modèle représente l’angle social du handicap. Ce modèle part du principe que c’est l’environnement construit socialement qui est handicapant. Des marches d’escaliers ou un site internet qui n’est pas pensé pour être accessible et qui, par voie de conséquence, devient handicapant en sont de parfaits exemples. Dans ce modèle, l’objectif vise à supprimer les barrières.
Finalement, le tout est lié, une technologie d’assistance est par définition un dispositif médical qui doit satisfaire différentes normes pour pouvoir être industrialisée puis commercialisée.
Comment se positionne le Valais au niveau de l’innovation dans le domaine des technologies d’assistance ?
Le Valais possède, dans ce domaine, une avancée certaine. Grâce à ses collaborations avec la Fondation Suisse pour les Paraplégiques et la Fondation Suisse pour les Téléthèse, l’institut de recherche Icare cumule près de 40 ans d’expérience dans ce domaine. Il est l’interlocuteur de référence pour la réalisation d’applications adaptées, centrées sur les besoins spécifiques des utilisateurs. La digitalisation des services parait être une excellente solution pour une meilleure inclusion sociale.
Du côté du Living Lab Handicap, ce dernier anime un processus d’innovation autour des technologies d’assistance grâce à l’Innovation Booster. En effet, en collaboration avec la HES-SO Valais-Wallis et la HE-Arc, la FRH a obtenu un financement Innosuisse d’environ 2 millions de francs suisses pour les années 2021 à 2024. Ce financement a pour but le soutien et la valorisation d’idées et de projets en lien avec le handicap et les technologies. Chaque année, trois appels à projet permettront à différentes équipes de proposer des projets avec et pour les personnes en situation de handicap. Chaque équipe soumettant un projet doit compter au minimum une personne concernée par le handicap. Cette personne doit être intégrée dans toutes les étapes du projet en tant que co-chercheuse afin de représenter la voix des personnes concernées. D’autre part, le jury qui se charge d’évaluer la pertinence des projets d’innovation doit comprendre deux scientifiques et deux personnes en situation de handicap.
Que peut-on espérer pour l’avenir ?
Le slogan de l’Innovation Booster se conjugue de la manière suivante : « Booster l’inclusion sociale en Suisse ». Cela induit une meilleure inclusion sociale de toutes les diversités sans distinction. « On espère avec l’Innovation Booster arriver à cet objectif d’inclusion en créant de nouvelles technologies d’assistance », déclare Benjamin Nanchen.
Julien Torrent conclue en affirmant : « Un avenir numérique sans barrière serait un idéal à atteindre. Cependant, différents freins existent actuellement, par exemple au niveau de la communication qu’elle soit écrite, orale ou visuelle. Pour tenter de pallier ce problème de manière systémique, au niveau Suisse, avec 6 autres partenaires de recherche et plusieurs partenaires industriels, nous élaborons actuellement un projet sur cette thématique dans le but d’améliorer la situation qui, à ce jour, n’est pas satisfaisante. »
À titre d’illustration, la start-up Eyeware, grande gagnante de la première édition de l’Arkathon en 2015, s’est illustrée dans le développement d’une solution de tracking des yeux qui offrait la possibilité aux personnes à mobilité réduite de faire fonctionner un ordinateur à l’aide de mouvements oculaires et de la tête.
Accompagnée depuis ses débuts par la Fondation the Ark, Eyeware cherche désormais à étendre les applications potentielles de sa technologie à l’industrie et au grand public tels que la robotique, l’assistance à la conduite, les études comportementales et de recherche clinique ou encore les jeux vidéo et de simulation.