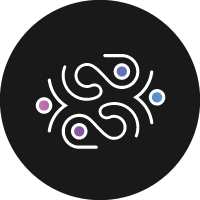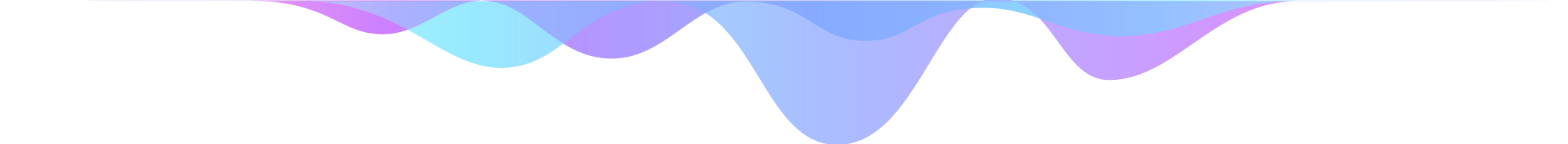Chaque mois, nous partons à la rencontre d’acteurs de l’écosystème de la santé et mettons en lumière les projets innovants qui font la médecine de demain. Aujourd’hui, découvrez le laboratoire Hummel de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). L’équipe de scientifiques du laboratoire focalise sa recherche sur les troubles neurologiques, dont les AVC, et le développement de traitements innovants et non invasifs, dans le but d’améliorer la récupération des fonctions sensorimotrices et cognitives. Afin de lever le voile sur cette nouvelle approche, nous avons rencontré le Professeur Friedhelm Hummel, neuroscientifique et directeur de la chaire Defitech de neuro-ingénierie clinique à la Faculté des sciences de la vie de l’EPFL.
Si l’accident vasculaire cérébrale (AVC) peut paraitre comme une pathologie peu courante, en réalité il atteint plus de 1,5 millions de nouveaux cas chaque année en Europe. L’AVC, ou communément appelé “attaque cérébrale”, survient lorsque le flux sanguin vers le cerveau est réduit voire interrompu. Les AVC peuvent, dans certains cas, être mortels. Lorsqu’ils ne le sont pas, ils peuvent entraîner des conséquences sévères sur la mobilité et les facultés cognitives des personnes qui en sont victimes. En effet, l’AVC est l’une des causes principales d’invalidité à long terme. Les processus de rééducation et de récupération sont souvent longs et difficiles, et la rééducation complexe.
En Valais, l’EPFL développe des projets autour des stratégies de traitement et de restauration des facultés du cerveau après un AVC. En collaboration avec l’Hôpital du Valais, la Clinique romande de réadaptation et la Clinique Bernoise de réadaptation de Montana (un centre de réadaptation stationnaire), le Professeur Friedhelm Hummel propose une approche non-invasive de stimulation électrique et magnétique du cerveau. Découvrons ensemble l’expertise du Professeur Hummel sur cette problématique médicale.
Pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous et sur vos activités professionnelles ?
J’ai fait mes études de médecine à Tübingen et à Bordeaux et me suis spécialisé en neurologie à Tübingen et à Hambourg. Les fonctions du cerveau et la manière dont on peut les influencer m’a toujours intéressé. Je me suis approché très tôt du domaine de la recherche scientifique, déjà pendant mes études et ma spécialisation notamment lors d’un séjour de recherche de deux ans auprès des National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis. Avant de venir en Suisse en tant que full professor à l’EPFL, j’étais à la clinique universitaire de Hamburg-Eppendorf (UKE), où j’ai occupé les postes de directeur adjoint du service de neurologie, de co-directeur du laboratoire universitaire du sommeil et de directeur du laboratoire BrainImaging and NeuroStimulation (BINS).
Mes domaines d’expertise sont les AVC, ainsi que les processus de récupération après un AVC. Mon laboratoire travaille également sur les troubles du mouvement ainsi que sur le vieillissement en bonne santé. Ma méthode se base sur la neuroscience des systèmes, c’est-à-dire que nous étudions le fonctionnement du cerveau dans son ensemble, plutôt que des composantes séparées comme certains récepteurs ou molécules. Ce qui nous intéresse, ce sont les interactions entre plusieurs régions du cerveau.
Quelle est la mission du laboratoire Hummel ?
La mission du laboratoire Hummel est d’appliquer les neurotechnologies au développement de traitements innovants et personnalisés, c’est-à-dire adaptés à l’individu, afin d’améliorer la récupération des fonctions sensorimotrices et cognitives chez les patients souffrants de troubles neurologiques, suite par exemple à un AVC ou à un traumatisme crânien, ou atteint par des troubles neurodégénératifs. Notre volonté est de faire passer ces neurotechnologies du « laboratoire au chevet du patient ». Une compréhension approfondie des mécanismes sous-jacents des troubles et des processus de récupération, ainsi que le développement de biomarqueurs, constituent une base importante pour atteindre cet objectif.
Pourquoi avoir choisi le Valais ?
À Sion, nous avons l’opportunité unique de pouvoir étudier le fonctionnement du cerveau chez les patients victimes d’AVC, grâce notamment à notre excellente collaboration avec deux centres hospitaliers majeurs, à savoir l’Hôpital du Valais, qui accueille environ 500 patients victimes d’AVC chaque année, et la Clinique romande de réadaptation, une des meilleures cliniques de rééducation en Suisse. En nous appuyant sur différentes technologies, nous pouvons suivre ces patients de la phase aiguë à la phase chronique de la pathologie. D’une part, nous étudions les changements qui ont lieu dans leur cerveau au cours du rétablissement, de l’autre, nous utilisons des technologies de neurostimulation du cerveau, par exemple pour améliorer la motricité des membres atteints par l’AVC. Ces technologies servent à moduler la plasticité du cerveau, c’est-à-dire sa capacité à se réorganiser. Lorsque nous apprenons une nouvelle tâche, la structure du cerveau se modifie. Il se réorganise et crée des circuits spécifiques à ce que nous avons appris.
Pourriez-vous nous expliquer brièvement votre idée ?
Notre idée est de combiner l’apprentissage d’une tâche avec la stimulation cérébrale, afin que l’apprentissage soit beaucoup plus efficace. Cela est important pour la neuro-réhabilitation des patients, car le réentraînement des fonctions perdues, suite à l’AVC, est la base de leur réadaptation. Si un patient a perdu beaucoup de mobilité, nous entraînons d’abord des mouvements très simples, comme l’ouverture de la main. Si le patient a plus de capacités, nous travaillons des mouvements plus complexes comme attraper des objets. Si le patient a un déficit très léger, l’entraînement sera axé sur la motricité fine. Ainsi, la difficulté et l’intensité des entraînements sont adaptées à chaque patient.
Quelle est la spécificité de votre approche ?
Notre approche est multimodale, c’est-à-dire que nous utilisons différentes technologies pour mesurer l’activité cérébrale comme l’imagerie par résonance magnétique (IRM), l’électroencéphalogramme (EEG), la stimulation magnétique transcrânienne ou encore des tests neuropsychologiques. Notre but est de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau et comment le moduler avec des moyens non-invasifs (par exemple la stimulation magnétique ou électrique transcrânienne). À terme, l’objectif est d’appliquer ces connaissances dans la pratique clinique et le traitement des patients.
Au-delà de l’AVC, dans quel autre cas la stimulation cérébrale peut être pertinente ?
Lorsque nous vieillissons, plusieurs mécanismes se produisent dans notre cerveau affectant presque tous les domaines cognitifs. On parle beaucoup des troubles de la mémoire dus au vieillissement, mais d’autres domaines cognitifs sont également touchés. Nos capacités à effectuer des tâches motrices comme courir, jouer du piano ou utiliser un ordinateur, se modifient. Nous sommes moins rapides et faisons plus d’erreurs qu’auparavant. L’apprentissage de nouvelles compétences devient plus difficile. L’activité physique et cognitive diminue le risque de développer un déclin cognitif ou une démence, c’est un fait maintenant bien établit. Un axe de notre recherche contre le vieillissement cognitif est la stimulation cérébrale non-invasive. Dans certaines de nos études, les participants prennent le stimulateur à la maison afin de s’entrainer de manière plus intensive. Nous espérons ainsi pouvoir, dans le futur, mieux cibler et prévenir le déclin cognitif lié à l’âge.